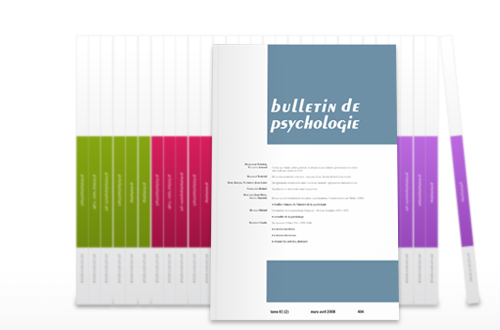
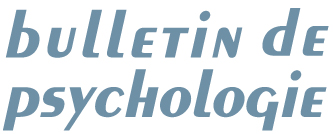
une documentation irremplaçable, avec des recensions
d’ouvrages et d’articles de revues.
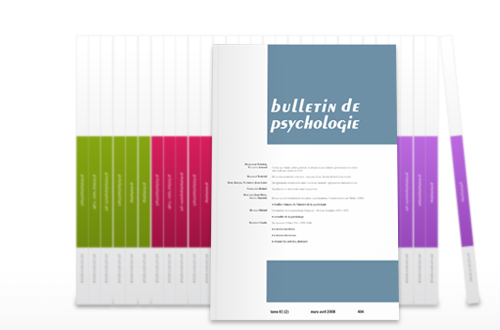
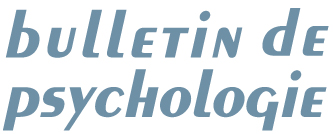
Catégorisation sociale et langage
Castel (Philippe), Lacassagne (Marie-Françoise).— Les partitions discriminantes
dans la negociation du contrat de communication, Bulletin de psychologie,
Tome 58 (3), N°477, 2005, p. 299-306.
Résumé :
Le but de cette recherche est de mettre en évidence l’existence de plusieurs
mécanismes de discrimination selon la cible visée. Plus précisément, une
partition hiérarchique ne devrait pas entraîner les mêmes effets qu’une
partition oppositive ou qu’une partition communautaire. Concrètement,
les sujets devaient écrire une lettre à un destinataire présumé (de par
son nom) être issu de l’immigration, d’origine africaine ou membre de
la communauté juive. L’analyse de discours fait, tout d’abord, apparaître
un effet « classique » de discrimination en introduisant un déséquilibre
au détriment de l’interlocuteur appartenant à un exogroupe, quel qu’il
soit. Mais elle révèle aussi, comme attendu, des distorsions particulières
pour chaque type de catégorisation, puisque ce déséquilibre porte sur
le registre professionnel dans le premier cas, sur les relations interpersonnelles
dans le deuxième et sur les appartenances culturelles dans le troisième.
Title: Types of categorization
in discriminative verbal interactions
Abstract : In this paper,
it was hypothesized that categorization based on hierarchical levels,
opposite classes or minority/majority groups introduces different types
of discrimination. Through an experiment based on direct interaction of
written exchanges between a French white person and someone presumed to
be weak status Immigrant, Black or Jude, we find a classical discrimination
effect and particular bias for each type of categorization.
Gilibert (Daniel), Sales-Wuillemin (Edith).— La discrimination « privative »
dans l’activité explicative, Bulletin de psychologie, Tome 58
(3), N°477, 2005, p. 307-320.
Résumé :
L’objectif de cette contribution expérimentale est de tester des hypothèses
relatives aux attributions causales entre groupes, appliquées à la catégorisation
« Français d’origine »/« immigré maghrébin ». Conformément à des convictions
non racistes, les sujets n’attribuent pas plus souvent à une personne
cible « d’origine maghrébine » qu’à une cible « Français d’origine »,
la responsabilité d’une conduite socialement indésirable. Néanmoins, ce
n’est pas pour autant qu’ils lui attribuent la responsabilité de sa conduite
socialement désirable, lorsqu’elle est « d’origine maghrébine », ce qu’ils
font, pourtant, dans le cas d’une cible « Français d’origine ». Ces résultats
sont interprétés comme étant l’expression d’une distorsion de discrimination
négative résultant de la gestion des stéréotypes. La discussion souligne
l’importance de tels résultats quant à la persistance des stéréotypes
chez des populations qui se veulent pourtant non racistes.
Title: The « subtle prejudice »
in intergroup causal attributions
Abstract : Intergroup causal
attribution processes were tested in the context of stereotypes of North
Africans in France. In line with a “politically correct norm” of anti-racism,
participants did not attribute undesirable behaviour more often to a North
African than to a French individual. Nevertheless they attributed socially
desirable behaviour less often to an individual when the person was North
African. These results are interpreted as an expression of the Privative
Discrimination Effect resulting from stereotype processing. The implications
of these findings are discussed with regard to the maintenance of negative
stereotypes.
Rey (Jean-Pierre), Weiss (Karine).— Marqueurs langagiers et relations
intergroupes : analyse de discours d’entraîneurs dans le jeu sportif collectif,
Bulletin de psychologie, Tome 58 (3), N°477, 2005, p. 321-328.
Résumé :
Cette recherche s’appuie sur l’analyse de discours, afin de mettre en
évidence des mécanismes liés à la catégorisation sociale dans une situation
de compétition sportive. L’analyse des indicateurs langagiers, issus des
discours d’entraîneurs, précédant une compétition sportive, permet de
relever des effets liés aux aspects, aussi bien catégoriels que fonctionnels
de cette compétition. Ainsi, dans une situation de compétition sportive
plutôt favorable à l’équipe, le discours ne vise pas à accentuer la différenciation
intergroupe, mais reflète aussi les stratégies de jeu. Au contraire, en
situation difficile ou incertaine, le discours reflète beaucoup plus les
effets classiques de la catégorisation sociale : effet d’assimilation
et dévalorisation de l’exogroupe.
Title: Linguistic markers
of intergroup relationships : an analysis of collective sport coaches’speeches
Abstract : This research
uses the discourse analysis in order to highlight mechanisms related to
social categorization in a situation of sport competition. The analysis
of linguistic indicators resulting from the coaches’ speeches before a
competition makes it possible to raise of some effects related to both
categorization and functional aspects of this competition. Thus, in this
specific social situation, when the competition seems rather favourable
to their team, the coaches do not aim at accentuating social categorization
but their discourses reflect the game strategies. On the contrary, in
a difficult or ambiguous situation, the coaches’ speeches reflect much
more the traditional effects of social categorization: assimilation and
devalorization of the exogroup.
Minondo-Kaghad (Brigitte), Sales-Wuillemin (Edith).— Les communications
fonctionnelles expert/novice : effet de la mise en saillance catégorielle
sur le pilotage du dialogue et la relation instaurée par le sujet avec
son partenaire, Bulletin de psychologie, Tome 58 (3), N°477,
2005, p. 329-338.
Résumé : L’expérimentation
porte sur une tâche de communication référentielle. L’effet de l’activation
de l’appartenance catégorielle du partenaire sur le pilotage du dialogue
et sur la relation instaurée avec son partenaire par le sujet est analysé.
Les sujets sont toujours novices et mis en position de meneurs. Trois
situations sont testées, dans lesquelles le niveau de compétence supposé
du partenaire est manipulé : 1° le partenaire est présenté comme étant
de même niveau d’expertise que le sujet (dyade novice/novice) ; 2° le
partenaire est présenté comme étant de niveau d’expertise supérieur au
sujet (dyade novice/expert) ; 3° rien n’est spécifié (dyade novice/indéterminé).
Les résultats montrent que c’est dans les deux premières situations que :
les interactions sont les plus longues, les procédures de contrôle les
plus nombreuses, le sujet se laisse le plus piloter par son partenaire.
Les résultats sont interprétés en termes d’ancrage et de co-construction.
Title: Functional communications
between experts and novices : effects of categorization on dialogue management
and relationship between the subject and his partner
Abstract : This experimental
study concerns a referential communication task. The aim is to analyse
the effect of activating the partner ?’s category membership on the strategy
for managing the dialogue and on the relation the subject sets up with
his partner. Subjects are always inexperienced (novices) and in the position
of leading the interaction. Three situations are tested. The supposed
level of expertise of the subject’s partner is manipulated : 1° the partner
is supposed to be of the same level of competence (dyad novice/novice)Â ;
2° he is supposed to have a superior level of competence (dyad novice/expert) ;
or 3° nothing is specified about him (dyad novice/non specified). Results
show that it is in the situations where the subject has expectations about
the competence of his partner that the interactions are the longest, the
control procedures the most numerous, and the subject lets himself be
led by his partner. Results are interpreted in terms of anchoring and
co-construction.
N’Dobo (André), Gardair (Emmanuelle), Lacassagne (Marie-Françoise).— Accessibilité
des catégories et favoritisme endogroupe : comment le discours permet-il
d’échapper à la pression normative ?, Bulletin de psychologie,
Tome 58 (3), N°477, 2005, p. 339-349.
Résumé :
La recherche présente s’inscrit dans le cadre de la théorie de la catégorisation
sociale. Elle a pour objectif de montrer que l’émergence du biais pro-endogroupe
dépend des critères qui organisent la partition catégorielle, ainsi que
du degré d’accessibilité de ces critères. En examinant la teneur des rapports
produits par 186 sujets, jugeant des candidats à une embauche, catégorisés
en fonction d’une appartenance ethnique et d’un niveau de compétence allégués,
il apparaît que la partition ethnique mobilise davantage l’attention et
l’intérêt des participants que la partition selon la compétence. Concrètement,
les analyses montrent que le favoritisme endogroupe ne se manifeste pas
lorsque le support de la décision ne permet pas de nuances. À l’inverse,
un effet de différenciation intergroupe est constaté dans le choix des
répertoires langagiers. Les sujets semblent actualiser la perception positive
de l’endogroupe en remplaçant la norme implicite de supériorité endogroupe
(« nous sommes meilleurs qu’eux ») par la norme de différence (« nous
sommes différents d’eux »). La discussion porte à la fois sur l’inégalité
d’emprise entre les critères et les niveaux d’accessibilité de la partition
catégorielle, et sur la façon dont les normes sociales dominantes affectent
les jugements intergroupes.
Title: Categories accessibility
and ingroup favouritism : Can discourse beats off normative effect ?
Abstract : In the frame of social categorization theory, the aim of this
study is to show that the ingroup bias may depend on social categorization
criteria, including their level of cognitive accessibility and also on
the characteristics of the social context. In order to examine these predictions,
186 participants carried out an evaluation task of several ingroup or
outgroup targets, being competent or not, in a simulated professional
hiring situation. The analysis of the data collected revealed that the
presumed ingroup bias wasn’t significant when the participants had to
explicitly decide to hire a candidate or not. On the contrary, the content
analysis of the arguments used to justify the decision varied according
to the ethnic category of the target. Thus, participants’ behaviours turned
to be ambivalent, the usual pattern “we are better than them” being replaced
by this new pattern“ we are different from them”. The results are discussed
in terms of inequality between criteria and levels of cognitive accessibility
of social categorization, and also in terms of how dominant social norms
affect the intergroup social judgment.
Sales-Wuillemin (Edith), Specogna (Antonietta).— Effet d’une partition
d’opinion sur l’apparition des biais perceptifs d’homogénéité, de contraste
et de favoritisme, Bulletin de psychologie, Tome 58 (3), N°477,
2005, p. 351-360.
Résumé :
L’expérimentation présentée a pour but la mise en évidence des biais perceptifs
d’homogénéité, de contraste et de favoritisme dans une partition sociale
particulière : le groupe d’opinion. Deux variables indépendantes sont
manipulées, la caractéristique du groupe (endogroupe versus exogroupe)
et le type de partition (en termes de clans versus de degrés). L’analyse
des résultats fait apparaître un effet de la variable caractéristique
du groupe. On note un biais d’homogénéité, de défavoritisme et de contraste
soi/groupe plus important lorsque le groupe est un exogroupe que lorsque
c’est un endogroupe. La variable partition a également un effet : il apparaît
un biais d’homogénéité et de favoritisme qui est plus important lorsque
la partition se fait en termes de clans que lorsqu’elle se fait en termes
de degrés. Un effet d’interaction est également noté, le biais de favoritisme
est plus important pour un endogroupe avec une partition en clans que
pour un endogroupe avec une partition en degrés.
Title: Effects of an opinion
partition on perceptive bias of homogeneity, contrast and preference
Abstract : The aim of this
experiment is to show perceptive bias of homogeneity, contrast and preference
in a particular social partition : the opinion group. Two independents
variables (IV) are manipulated, the type of group (in-grx?oup versus out-group)
and the type of partition (“clan partition” versus “degree partition”).
The results show an effect of the IV type of group. The contrast subject/group
and the homogeneity and preference bias are more important for the “clan
partition” than for the “degree partition”. An interaction effect appears,
the preference bias is more important for an in-group with a “clan partition”
than for an in-group with a “degree partition”.
Syssau (Arielle), Font (Noëlle).— Évaluations des caractéristiques émotionnnelles
d’un corpus de 604 mots, Bulletin de psychologie, Tome 58 (3),
N°477, 2005, p. 361-367 .
Résumé :
Dans ce travail, nous présentons une norme concernant la dimension émotionnelle
de 604 mots, effectuée à partir d’une évaluation de la valence avec une
échelle nominale à trois modalités (négatif, neutre et positif) et d’une
évaluation de la valence combinée à l’intensité avec une échelle ordinale
bipolaire relative en 11 points. Au total 600 participants ont participé
Ă ces deux Ă©valuations. Les classifications des mots obtenues Ă partir
de ces deux types d’échelle diffèrent. Les mots classés comme étant indubitablement
de valence positive ou négative dans la première évaluation ne sont pas
pour autant tous classés parmi les mots les plus intenses dans la deuxième
évaluation. D’un autre côté, la prise en compte des résultats des deux
évaluations est particulièrement heuristique pour l’identification de
mots réellement neutres. Ces deux évaluations viennent compléter les normes
sur la dimension émotionnelle déjà existantes et devraient favoriser la
manipulation expérimentale de facteurs sémantiques dans les recherches
en psycholinguistique.
Title: Evaluations of emotional
characteristics of a set of 604 words
Abstract : In this study,
we present a norm that concerns the emotional dimension. This norm contains
604 words and is established from a valence evaluation constituted with
a 3-modality scale (negative, neutral and positive) and from a valence
combined with intensity evaluation through a relative bipolar ordinal
scale reaching 11 points. Upon the whole, 600 participants passed both
evaluations. The word classifications obtained from both scales are different.
Words indubitably categorized with a positive or negative valence
in the first evaluation are not necessarily all categorized as the most
intensive words in the second evaluation. In an other side, the whole
results from both evaluations taken together into consideration are particularly
heuristic for the identification of truly neutral words. Both evaluations
are complementary of already published emotional norms and should favour
the experimental manipulation of semantic factors in psycholinguistic
research.
•
autres travaux
Le Polain de Waroux (Geoffroy), Baruffol (Eric), Van Broeck (Nady), Lietaer
(Germain), Dekeyser (Mathias).— Orientations et intégration des psychothérapies
en Belgique, Bulletin de psychologie, Tome 58 (3), N°477, 2005,
p. 377-386.
Résumé :
Dans le courant de l’année 2001-2002, 955 psychothérapeutes ont répondu,
par courrier, à une enquête nationale sur le profil professionnel du psychothérapeute
en Belgique. Cette enquĂŞte comprenait, entre autres, plusieurs questions
concernant les orientations psychothérapeutiques et le thème de l’intégration
des psychothérapies. Les analyses concernant ces aspects ont abouti aux
conclusions suivantes. Premièrement, alors qu’en Belgique francophone,
le courant psychodynamique, suivi du courant systémique, sont les plus
choisis, en Belgique néerlandophone, ce sont les courants humaniste-expérientiel
et cognitivo-comportemental qui priment. Deuxièmement, les thérapeutes
belges interrogés semblent avoir une attitude peu favorable à l’intégration
des psychothérapies, en comparaison des résultats observés dans les pays
anglo-saxons, notamment (ex : Lambert, Bergin, Garfield, 2004). Finalement,
les différentes orientations semblent plus se ressembler sur le terrain
que ce qu’on pourrait ou ne voudrait croire sur base des théorisations
spécifiques de chacune d’elles.
Title: Psychotherapeutic
orientations and psychotherapy integration in Belgium
Abstract : In the years
2001-2002, 955 Belgian psychotherapists replied by mail to a national
survey on their professional style. The survey included questions concerning
the psychotherapeutic orientations and the theme of psychotherapy integration.
The data analyses concerning these aspects lead to the following conclusions :
First, while in French-speaking Belgium the psychodynamic and systemic
approaches are the most prevalent ones, in Flemish-speaking Belgium, the
humanistic-experiential and the cognitivo-behavioral approaches prevail.
Second, the Belgian psychotherapists seem to be less in favour of psychotherapy
integration compared to the results observed in the anglo-saxons countries
notably (e.g. Lambert, Bergin, Garfield, 2004). Finally, the different
psychotherapeutic orientations seem to resemble each other more in the
field of pratice than one could or would believe on the basis of their
often divergent theoretical background.
Temple (Caroline).— Stratégies identitaires, durée d’acculturation et
orientations personnelles : quel lien avec l’estime de soi ? Le cas des
migrants Japonais, Bulletin de psychologie, Tome 58 (3), N°477,
2005, p. 369-375.
Résumé :
Si l’opération identitaire consiste en un réaménagement permanent des
différences en vue de maintenir un sentiment d’unité, qu’advient-il de
la stabilité identitaire du migrant chez qui les valeurs et représentations
de plusieurs codes culturels, souvent contradictoires, coexistent ? La
notion de stratégie identitaire permet d’envisager les modes de restructuration
de l’identité du migrant à partir de différentes formes de gestion des
conflits et de leur polarité. L’auteur cherche à mesurer l’impact de plusieurs
variables sur l’emploi des stratégies identitaires. Une première enquête
par questionnaire et entretiens libres, réalisée auprès de 40 ressortissants
Japonais en France, révèle une absence de lien entre stratégies identitaires
et estime de soi. En revanche, la nature de l’activité exercée influe
fortement sur l’orientation des stratégies. L’auteur conclut sur la présence
de stratégies non envisagées.
Title: Identity strategies, acculturation duration and personal orientations :
which link with self esteem ? The case of japanese migrants
Abstract : Identity dealing
consists of a continuous adjustment to differences in order to maintain
a feeling of unity. Therefore, when different and often contradictory
values and representations of several cultural codes coexist, what happens
to the identity stability of a migrant ? The identity strategy concept
permits to understand the modes of identity restructuration used by the
migrant considering the differents forms of conflicts resolving and their
polarity. The author tries to assess correlations between several variables
and the use of identity strategies. A prime survey was carried out by
both questionnaire and free talk with 40 Japanese nationals in France.
The results show that there is no link between identity strategies and
self esteem. In contrast, the nature of practised activity has a strong
influence upon the orientation of the strategies. The author notices unexpected
strategies appear in this sample.
Soutenances de thèse
Besse (Richard).— Territoires de la psychologie et identité du psychologue ; des questions épistémologiques aux problèmes de la pratique à l'école. Penser la psychologie, Bulletin de psychologie, Tome 58 (3), N°477, 2005, p. 387-389.
Bioy (Antoine).— La relation inter-individuelle en hypnose clinique et sa dynamique thérapeutique, Bulletin de psychologie, Tome 58 (3), N°477, 2005, p. 391-393.
• à travers les livres • à
travers les revues • actualité de la psychologie •
résumés des articles